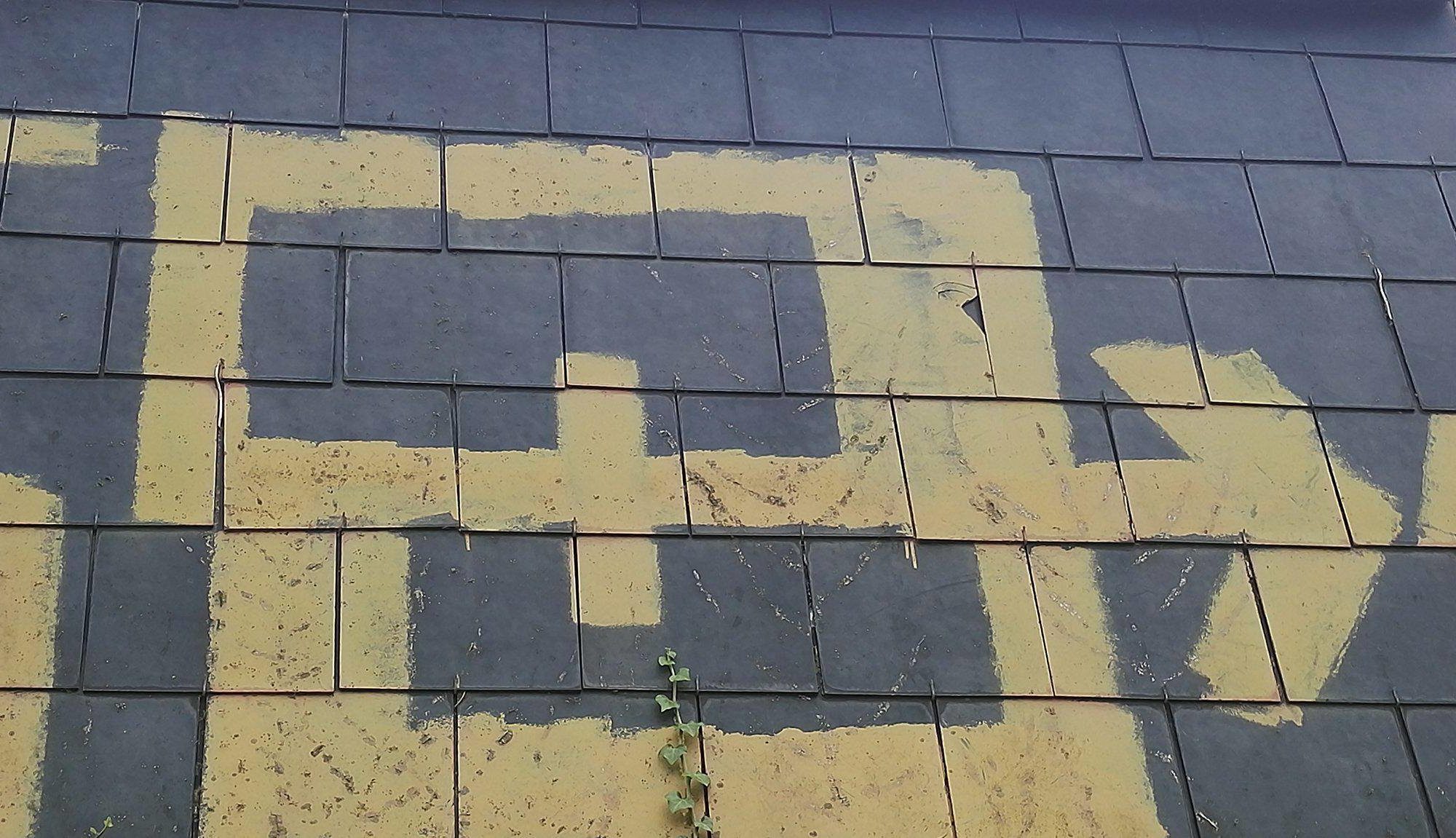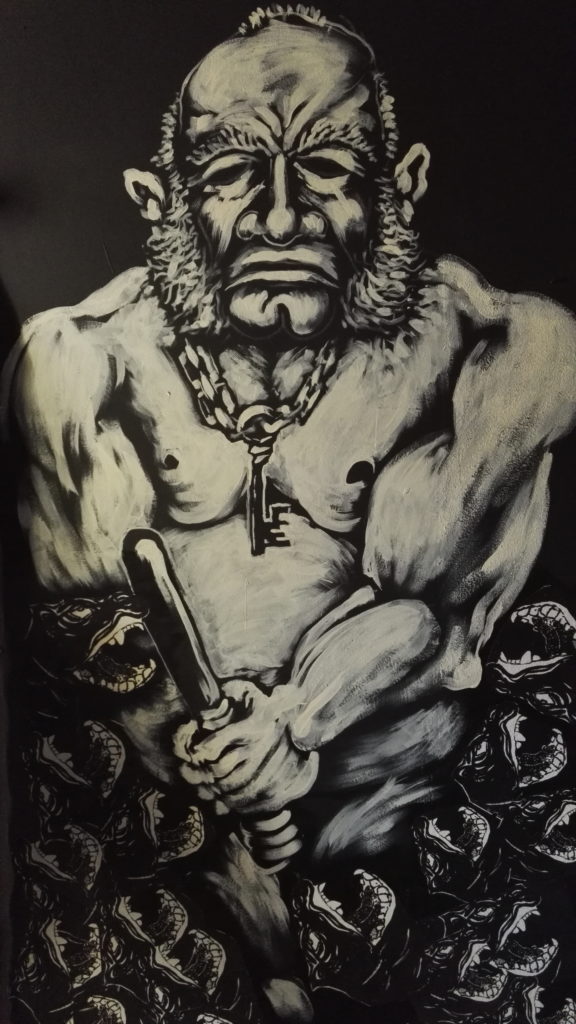En avril dernier, j’ai fait une petite infidélité au blog pour écrire sur Let’s Look After,
https://letslookaftersite.wordpress.com/ une jeune revue féministe numérique, d’où mon silence prolongé. J’y ai parlé de la condition des femmes détenues. Un sociologue aurait sûrement mieux étudié la chose, je vous conseille d’ailleurs les passionnants travaux de Natacha Chetcuti-Osorovitz, mais derrière mon bureau, des patientes me racontent souvent des bribes de leur détention et m’ont fait beaucoup réfléchir sur la question du genre en prison.
Les femmes représentent 3.5% des personnes détenues en France. Parce qu’elles sont en extrême minorité, elles se retrouvent exclues parmi les exclus. Car le système carcéral refuse la mixité.
Voulant protéger les femmes détenues des assauts de prisonniers forcément en proie à des pulsions d’autant plus irrépressibles que les rapports sexuels au parloir avec leurs compagnes sont interdits, l’administration pénitentiaire les confine dans un quartier spécifique au sein des prisons mais les moyens ne sont pas là pour assurer une équité de traitement. Seuls 56 établissements pénitentiaires (sur 188) disposent de tels quartiers, allant de 5 places comme à Saintes en Charente-Maritime à 237 comme à Fleury-Merogis. Il est donc probable que la femme détenue se retrouve loin de chez elle, loin de ses enfants qu’elle ne pourra pas voir voir facilement, et loin de son compagnon, même s’il est probable qu’il ait déjà mis un terme à leur couple, contrairement aux épouses et petites amies de détenus, qui maintiennent beaucoup plus souvent et plus longtemps la relation. Ainsi, pour la femme incarcérée, le délitement des liens sociaux est rapide et l’horizon se limite très vite à la carcéralité.
Une rude carcéralité car, contrairement aux détenus hommes, elles n’ont pas droit à la période d’accueil et d’observation destinée à atténuer le choc de l’incarcération. Dans les petites maisons d’arrêt, elles peuvent se retrouver totalement seules si par hasard il n’y a pas d’autres femmes incarcérées au même moment qu’elles. Elles n’ont accès aux activités proposées (cours, sport, formations) que sur des créneaux horaires restreints. Elles bénéficient peu, comparativement aux hommes, de la semi-liberté, qui permet de travailler à l’extérieur en journée et de revenir le soir en détention.
Dans cet univers clos, coercitif et hiérarchisé, une conception patriarcale de la féminité continue de faire pression sur les femmes. Ainsi si il n’y a pas d’hommes ni parmi les détenus ni parmi les surveillants en contact direct avec les femmes incarcérées, ils sont présents aux postes plus gradés. Ils sont donc amenés à prendre des décisions réglant la vie des détenues et parfois lourdes de conséquences : changement de co-cellulaire, mise au quartier disciplinaire…
Les difficultés liées à la surpopulation carcérale, le racket, y sont souvent souvent ramenés à de simples querelles « de filles ». Non que ces problèmes trouvent davantage leurs solutions dans les quartiers d’hommes, mais on en fait ici une interprétation différente, avec comme conséquences une attitude paternaliste et infantilisante envers les détenues.
Le règlement intérieur et les produits disponibles à la cantine (commandes hebdomadaires que les détenues passent pour améliorer l’ordinaire, payées avec l’argent envoyé par les familles ou gagné en travaillant en détention) reproduisent à l’intérieur des murs le contrôle social sur l’apparence et la séduction féminine, avec toute l’ambivalence que l’on retrouve à l’extérieur. Ainsi, à côté d’une incitation à à « ne pas se laisser aller » et à « prendre soin de soi » à travers le sport ou des soins esthétiques qui peuvent être proposés à des femmes jugées narcissiquement fragiles, on trouve des règlements intérieurs interdisant shorts et débardeurs dans les espaces de circulation et prohibant le parfum. Les seuls sous-vêtements disponibles à la cantine sont des brassières de sport Décathlon. Est-ce à dire qu’on considère que le port d’un soutien-gorge un tant soit peu féminin n’a de sens qu’avec le regard d’un homme pour le voir ? L’administration pénitentiaire penserait-elle que trop d’apprêt signe forcément une tentative de séduction et donc de corruption de la part des Eves incarcérées envers les gradés ?
Enfin, il existe en prison parmi les détenues une forme d’ordre social, informel mais reconnu par toutes et tous, détenues, surveillantes et gradés, qui a tout à voir avec la représentation de la nature féminine. Il y a les caïds, celles qui, comme leurs homologues masculins avec qui elles partagent postures langage, se sont lancées de manière autonome et avec succès dans le trafic de stupéfiants. Leur comportement irrite et leur attitude provocatrice les amène souvent à un bras de fer avec l’administration pénitentiaire, qui se solde par des sanctions ou des peines supplémentaires. La Justice pourtant peut se montrer plus indulgente qu’avec les trafiquants masculins, pourvu qu’elle puisse percevoir une fragilité ou une naïveté, le meilleur exemple étant celui de la jeune femme se laissant embarquer par son amour pour un dealer.
Il y a les femmes coupables d’homicides, bien souvent sur un compagnon violent au terme d’années de maltraitance, qui commencent parfois dans l’enfance et se poursuivent ensuite avec un homme, ou plusieurs dans une répétition de l’histoire traumatique. Leur parcours pénal va être marqué par une grande ambivalence : entre injonction à reconnaitre sa culpabilité, sous forme d’expressions de remords, d’acceptation pleine et entière de la durée de la peine et de paiement de parties civiles, et reconnaissance de soi-même en tant que victime, statut en général jamais pensé et jamais entériné par la Justice faute de plainte, et pourtant indispensable à la reconstruction de soi. Cette ambivalence se retrouve dans les mesures d’aménagement de peine (libération conditionnelle, bracelet électronique) qui sont parfois refusées car le juge craint si le compagnon n’est pas décédé une vengeance ou la poursuite de la relation d’emprise. Il ordonne donc la poursuite de l’incarcération comme une « mesure de protection » pour la femme…
Il y a enfin, au bas de la hiérarchie sociale qui s’établit en prison, les femmes infanticides. L’infanticide garde une part d’incompréhensible contre laquelle toutes les remises en contexte et toutes les expertises psychologiques ne peuvent lutter. C’est le crime parmi les crimes. Parce qu’il semble en contradiction absolue avec le fameux instinct maternel, cet amour et ces soins que toute femme donnerait de façon innée à son bébé, la femme coupable d’infanticide est jugée monstrueuse, contre-nature. Elles ne sont pas fréquentables et sont souvent rudoyées en cas de cohabitation forcée. Aussi taisent-elles ce qui les amènent en détention, cachent toute photo, tout souvenir et toutes larmes, de peur de se voir ostraciser, ce qui rend le travail de deuil difficile.
Ce rapide tour d’horizon de la situation des femmes incarcérées, à travers les observations que j’ai pu faire dans le cadre de mon exercice de la médecine en milieu pénitentiaire et les données de l’Observatoire international des prisons, montre bien que la prison a été construite par et pour des hommes, obéissant à une logique du nombre sur laquelle il serait également bon de se questionner, l’idéal de masculinité n’étant probablement pas étranger à la sur-représentativité des hommes parmi la population délinquante. Néanmoins, il y a des femmes incarcérées et malgré que la politique pénale prévoit de construire encore davantage de prisons, la question de l’amélioration de leur situation n’est jamais évoquée. Pourtant, la prison fait partie de la République et dedans comme dehors, l’égalité est y un droit.
Sources :
Femmes détenues – Observatoire international des prisons https://oip.org/decrypter/thematiques/femmes-detenues/