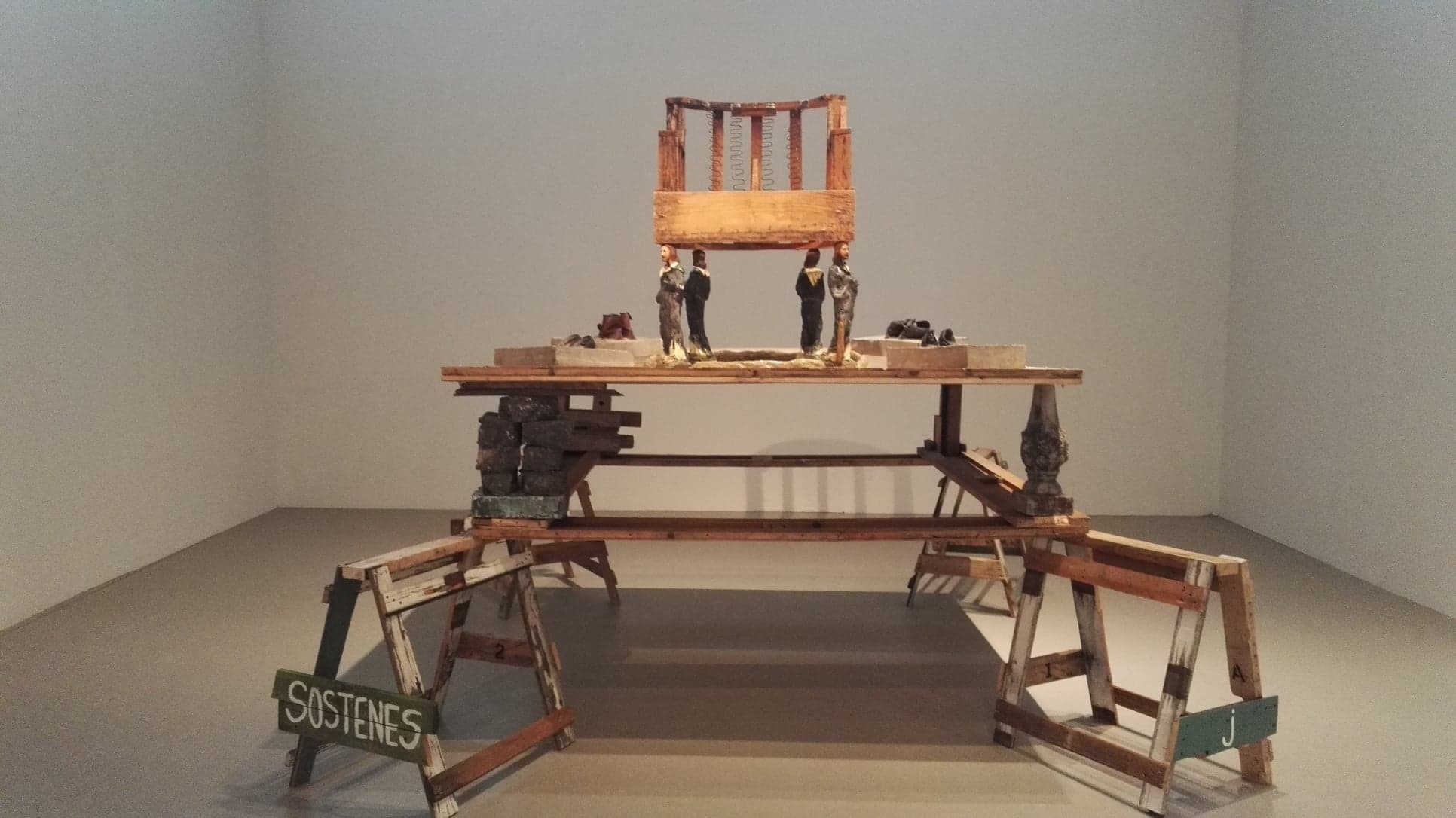« Attention au militantisme » Il y a un peu plus d’un an, ma cheffe de pôle m’avait fait cette mise en garde, à un moment où notre service était confronté à des décisions politiques qui me paraissaient aberrantes. J’ai été tentée de n’y voir qu’une exhortation au calme devant la fougue de ma jeunesse mais, au vu de son expérience et de son engagement, je n’ai pas pu m’en convaincre totalement. Cette remarque et la question des liens entre psychiatrie et politique ne m’ont pas quittée au fur et à mesure que j’étais moi même confrontée à de tels enjeux.
Quand un sujet est aussi complexe que celui-là, je trouve qu’un point étymologique est toujours un bon début. Sur le radical polis qui désigne la cité, les grecs ont forgé trois mots :
Politikos qui désigne la société organisée et développée
Politea qui concerne la constitution et le fonctionnement d’une communauté, d’une société, d’un groupe social, la politique portée sur les actions, l’équilibre ou le développement interne ou externe de cette société.
Et enfin Politiké la pratique du pouvoir, c’est à dire les luttes pour le pouvoir et la représentativité du peuple.
Le deuxième concept, celui de Politea, nous éclaire tout particulièrement et nous permet de comprendre pourquoi la politique peut s’intéresser légitimement à la folie/maladie mentale. Les personnes souffrant de pathologies psychiatriques voient bien souvent leur rapport à la société, à autrui, se modifier : elles peuvent être vulnérables et menaçées, être exclues de la vie collective et citoyenne car leurs capacités cognitives et relationnelles sont entravées ou car elles font l’objet de discrimination, mais aussi être perçues, le plus souvent à tort mais parfois à raison, comme menaçantes pour leurs semblables ou pour la tranquillité publique. On voit dès lors se dégager les deux versants que peut prendre l’intérêt de la politique à l’endroit des malades mentaux et par voie de conséquence à la façon dont la psychiatrie les prend en charge : la protection et l’inclusion dans la société, mais aussi la défense sociale.
En parallèle, la psychiatrie cherche elle-même à définir son objet et n’est pas étanche, dans ses recherches, aux évolutions sociétales. Michel Foucault va jusqu’à parler de « psychopathologie comme fait de civilisation », considérant que la maladie mentale est le produit de conditions historiques et plus encore d’un contexte culturel particulier. Il signifie par là que la psychiatrie est liée à la définition de normes sociales et à ce qu’il nomme les « régimes de vérité » pour une société donnée à un moment donné. Deux exemples sont particulièrement frappants. Celui de l’homosexualité, considéré comme une pathologie psychiatrique jusqu’en 1973 aux Etats-Unis, 1992 en France . Et la psychiatrie soviétique de l’ex-URSS, où les dissidents politiques se voyaient affublés du diagnostic de « schizophrénie torpide ». Au-delà d’avoir été un instrument au service du pouvoir politique en place, le drame est que les psychiatres ayant posé ces diagnostics ont pour certains agi en toute bonne foi, estimant que ne pas adhérer à la ligne du Parti relevait de toute évidence d’un défaut d’adaptation pathologique.
Depuis la fin du XIXème siècle, l’aliénisme devenu psychiatrie assume également d’assurer des missions d’ordre public, trouvant sa légitimité dans le développement concomitant de l’hygiène publique et de la théorie de la dégénérescence de Bénédict Augustin Morel. La psychiatrie fait aussi son entrée, par l’intermédiaire de l’expertise notamment, au sein même de la société.
En 1980, le terme de maladie mentale disparaît des classifications officielles, au profit de la notion de « troubles », qui réintroduit l’ambiguïté du statut médical de la psychiatrie, l’éloignant de la folie pour la rapprocher de l’étude des comportements troublés voire déviants. Voilà qui n’est peut-être pas sans rapport avec le fait que la psychiatrie soit aujourd’hui convoquée sur des sujets aussi divers que le modèle parental à légitimer ou le radicalisme islamique et sa prévention.
Il est donc illusoire, malgré le concept d’ « evidence-based-medecine » ou médecine basée sur les preuves de penser la psychiatrie comme étant en dehors du champ politique, dans une sorte de neutralité scientifique.
Alors de quelle place peut parler le psychiatre et que vaut son discours ?
Il me semble qu’il y a à l’égard de la psychiatrie, à la fois une grande attente et une grande défiance. On la dit en déshérence, au bord du gouffre. On critique ses abus, la représentation populaire étant encore aujourd’hui celle de la psychiatrie asilaire, où le malade est soumis à la toute-puissance médicale qui s’exerce sous forme de camisole, chimique ou non. Le législateur intervient alors, non sans raison, pour en limiter les pouvoirs. Mais la vox populi, sortant parfois de la bouche d’un représentant élu, crie aussi au laxisme lorsqu’un crime semblant relever de la folie, est commis. On aimerait la voir respecter les libertés individuelles lorsque l’on s’imagine patient, et défendre les intérêts de la société contre la figure si étrangère à nous-même du malade dangereux.
Définir dans quelle mesure il est possible de restreindre la liberté au nom du risque, voilà une question éminemment politique, à laquelle le psychiatre ne peut et ne doit répondre seul, tant elle engage un projet de société. Mais il a quelque chose à dire sur le risque. Il vit avec, tous les jours il le pèse, avec le bénéfice, dans sa fameuse balance. Il connaît le risque de la rechute, qui pour autant n’est jamais certaine. Le médecin sait le poids de l’incertitude, quand il ne peut malgré les données statistiques, prédire l’évolution d’un individu. Il sait qu’on peut être protégé de la maladie, jusqu’au moment où elle surgit comme un coup de tonnerre dans un ciel serein.
Si on l’écoute, le praticien pourra dire qu’il n’y a pas de soins sans prise de risque, il n’y a que de l’emprisonnement. Il pourra proposer de regarder l’apparente opposition entre un engagement du médecin envers son malade ou envers la société sous l’angle de l’éthique médicale, « l’exigence d’une forme de comportement de la médecine au service du malade, de l’individu en face de lui, mais aussi de toute personne qui pourrait se retrouver un jour en position de malade ». Vous, moi, n’importe quel citoyen.